DADO (par Régine)
Né en 1933 au Monténégro, Dado est mort il y a quelques mois. Si en France sa disparition est passée presque inaperçue, des funérailles nationales ont été célébrées dans son pays. La galerie Jeanne Bucher répare actuellement cet oubli par une exposition réunissant trois grands triptyques, des dessins et des collages.
Le lien qui unit la vie et la mort, le rêve (ou plutôt le cauchemar) et la réalité, la fusion des règnes minéral, végétal et animal ont rarement été représentés de façon plus saisissante. Il faut dépasser un premier état de stupéfaction et de choc pour oser regarder ces toiles en face ; en effet, avant de les voir, l'oeil les subit. Certes, le monde qu'on a sous les yeux est irréel, mais il renvoie à toutes les horreurs dont l'hisoitre humaine est jonchée et nous met au coeur d'une humanité tour à tour souffrante et torturante. Passée cette secousse, il ne faut plus cesser de regarder, regarder encore et encore pour ne rien perdre de ce fourmillement de détails, de cet engendrement de formes, de leur agencement, de la finesse des filaments qui enserrent souvent ce monde grouillant. Ces espaces insoutenabls sont paradoxalement exaltés par une palette de couleur raffinées qui, telles une buée, se seraient déposées sur eux.
Dans le triptyque intitulé Bowery et qui date de 1975 (195 x 450) les deux tiers supérieurs des trois toiles qui le composent sont occupés par un ciel bleu lavande, vide, lavé, tandis que dans le tiers inférieur, baignant dans la même atmosphère, des êtres sont voués à la dévoration, à la transformation et à la décomposition. Dans le panneau de gauche par exemple 


Dans Le Boucher de St Nicolas
Du panneau de gauche du triptyque intitulé Boukoko (162 x 454), baignant un univers bleuté, le visage d'un monstre appartenant encore à l'espèce humaine jaillit 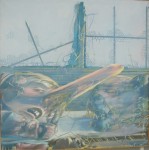
L'univers de ces toiles s'enracinent clairement dans l'histoire personnelle de Dado qui, enfant, a vécu les atrocités de la dernière guerre dans les Balkans, mais elles sont aussi de magnifiques morceaux de peinture. Nul mieux que Bernard Noël n'a su trouver les mots pour le dire : "Viande picturale tantôt charnue, tantôt aérienne, cette "viande" aux multiples avatars c'est la peinture. La peinture de Dado est viandeuse et non pas esthétique, l'imagze ne dépeint pas du massage du charnel, du pantelan, elle en contient."
Ce peintre est aussi un visionnaire de la trempe de Gérôme Bosch et sa peinture nous renvoie à tous les massacres contemporains.
Hommage à Miodrag Djuric, Dado. Galerie Jeanne Bucher, 53 rue de Seine, 75006-Paris (01 44 41 69 65) du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h jusqu'au 14 mai.

 (photo 2) et "Picasso défiguré (Les demoiselles d'Avignon)" (2011)(photo 3)
(photo 2) et "Picasso défiguré (Les demoiselles d'Avignon)" (2011)(photo 3)







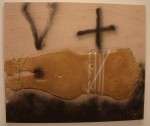
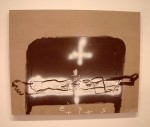






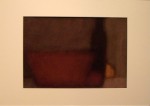
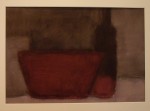

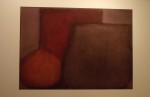













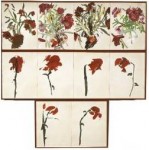 rupestre ou Cézanne, Rembrandt, le paysage ou la photo est à prendre comme un questionnement sur la peinture et la quête d'une nouvelle expression
rupestre ou Cézanne, Rembrandt, le paysage ou la photo est à prendre comme un questionnement sur la peinture et la quête d'une nouvelle expression 

