Vitraux , mon beau souci ( par Sylvie)
Cliquez sur les photos pour les agrandir.
La reconstruction de Notre Dame a fait l'unanimité. La dynamique des entreprises, les images du colossal travail acrobatique du chantier ont suscité un enthousiasme rare pour un bâtiment publique. Mais il s'agit là d'un sanctuaire, de la grande histoire de Paris et de la chrétienté. Il devrait être terminé fin 2026. Et voilà qu'un violent débat a opposé les partisans de vitraux actuels dans les chapelles sud, aux défenseurs de ceux mis en place au XIXème siècle par Violet le Duc : "On ne touche pas au patrimoine" ! Des vitraux ont pourtant été créés au fil des siècles, pourquoi pas aujourd'hui, d'autant plus que depuis la fin des années 80 les commandes publiques sont un précieux soutien financier.
 A l'heure où nous écrivons, en principe, ceux de la jeune artiste de 43ans, Claire Tabouret, en collaboration avec l'atelier de maitres verriers Simon-Marq sur le thème de la Pentecôte, ont été choisis, réalisation contemporaine de silhouettes fragiles, presque classiques (photo 1,maquette). Ils figurerons dans le patrimoine de demain.
A l'heure où nous écrivons, en principe, ceux de la jeune artiste de 43ans, Claire Tabouret, en collaboration avec l'atelier de maitres verriers Simon-Marq sur le thème de la Pentecôte, ont été choisis, réalisation contemporaine de silhouettes fragiles, presque classiques (photo 1,maquette). Ils figurerons dans le patrimoine de demain.
Voici quelques exemples de bonne facture , parmi beaucoup d'autres , pour tous ceux que ça n'effleurait pas de confondre temps de réalisation et style.
 S'inscrivant dans l'architecture gothique et magnifiant l'édifice par la diffusion de la lumière colorée., l'art du vitrail s'est développé au XIIème siècle. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que l'art abstrait a été considéré comme porteur d'une dimension spirituelle. Elle est tangible dans la peinture de l'époque, et le vitrail n'y échappe pas, compte tenu d'un renouveau de l'art sacré. Sur le plateau d'Assy, en haute Savoie, à la fin des années 40, Rouault (1871-1958) a marqué d'un style déja moins conventionnel l'église ND de toute grâce. (2)
S'inscrivant dans l'architecture gothique et magnifiant l'édifice par la diffusion de la lumière colorée., l'art du vitrail s'est développé au XIIème siècle. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que l'art abstrait a été considéré comme porteur d'une dimension spirituelle. Elle est tangible dans la peinture de l'époque, et le vitrail n'y échappe pas, compte tenu d'un renouveau de l'art sacré. Sur le plateau d'Assy, en haute Savoie, à la fin des années 40, Rouault (1871-1958) a marqué d'un style déja moins conventionnel l'église ND de toute grâce. (2)
 Vers la fin des années 40, Alfred Manessier (1911-1993) fut l'un des premiers artistes d'après guerre , et prolifique, à faire du vitrail. La plus connue de ses réalisations est une série de 31 pièces sur le thème de la Passion et de la Résurrection en l'église du Saint Sépulcre d'Abbeville (1982-1993). Membre de "L'Ecole de Paris", donc non figuratif, son motif multicolore, ascensionnel , a fort à voir avec les flammes. de l'enfer (3).
Vers la fin des années 40, Alfred Manessier (1911-1993) fut l'un des premiers artistes d'après guerre , et prolifique, à faire du vitrail. La plus connue de ses réalisations est une série de 31 pièces sur le thème de la Passion et de la Résurrection en l'église du Saint Sépulcre d'Abbeville (1982-1993). Membre de "L'Ecole de Paris", donc non figuratif, son motif multicolore, ascensionnel , a fort à voir avec les flammes. de l'enfer (3).
 Marc Chagall (1887- 1985) a participé à plusieurs édifices entre 1958 et 1984 dont deux grands chantiers à Reims en 1974 et à Metz en 1959. Là, dans la cathédrale, il ne fit pas moins de 6.500 m2 sur le thème de la vision de l'ange sur l'échelle de Jacob. Comme dans toute sa peinture, il y associe des éléments de sa propre culture, yiddish, slave, biblique, et de son imaginaire. Et sa patte reflète les avant-gardes de l'époque : fragmentation cubiste, couleurs du fauvisme. Il interprète, combine et, comme par magie, fait exploser ce petit monde de joie ou de rêve vivifiant. De quoi convaincre tous les croyants. (4)
Marc Chagall (1887- 1985) a participé à plusieurs édifices entre 1958 et 1984 dont deux grands chantiers à Reims en 1974 et à Metz en 1959. Là, dans la cathédrale, il ne fit pas moins de 6.500 m2 sur le thème de la vision de l'ange sur l'échelle de Jacob. Comme dans toute sa peinture, il y associe des éléments de sa propre culture, yiddish, slave, biblique, et de son imaginaire. Et sa patte reflète les avant-gardes de l'époque : fragmentation cubiste, couleurs du fauvisme. Il interprète, combine et, comme par magie, fait exploser ce petit monde de joie ou de rêve vivifiant. De quoi convaincre tous les croyants. (4)
C'est un grand ensemble abstrait que fit Jean Bazaine (1904-2001)  en 1970 dans le cœur de l'église gothique flamboyant de St Séverin à Paris. Classique dans sa thématique , cette série assez exaltante, vibre d'un mélange de couleurs fortes, chaleureuses et mouvantes. qui accompagne les volutes de la structure porteuse, toute tendue vers un monde d'en haut.. (5)
en 1970 dans le cœur de l'église gothique flamboyant de St Séverin à Paris. Classique dans sa thématique , cette série assez exaltante, vibre d'un mélange de couleurs fortes, chaleureuses et mouvantes. qui accompagne les volutes de la structure porteuse, toute tendue vers un monde d'en haut.. (5)
Les 104 vitraux de l'église Ste Foy de Conques ont été conçus par Pierre Soulages. (1919-2022) en 1987. Les aplats de couleur noire sont emblématiques de son travail de peintre, mais impropres à la transparence. Plutôt que la couleur, l'artiste a choisi le blanc, un blanc opalescent, en bandes plus ou moins horizontales superposées, qui laissent passer l'éclat du jour et entretient son mystère, divin pour qui veut. (6)
en 1987. Les aplats de couleur noire sont emblématiques de son travail de peintre, mais impropres à la transparence. Plutôt que la couleur, l'artiste a choisi le blanc, un blanc opalescent, en bandes plus ou moins horizontales superposées, qui laissent passer l'éclat du jour et entretient son mystère, divin pour qui veut. (6)
 La marque de fabrique de Claude Viallat, (né en 1936) est, elle aussi, bien connue des amateurs d'art contemporain. A priori son motif, une forme neutre, rectangulaire, ondulée, ne stimule pas l'imaginaire mais permet moult déclinaisons. C'était une gageure d'en faire un motif religieux (1993). Et pourtant, à N.D. des Sablons d'Aigues-Mortes, dans le Gard, un édifice du XIIIème siècle, "ces haricots" colorés, régulièrement espacés dessinent dans leur alignement une croix. Et leurs couleurs vives, se projetant par instants sur la pierre, semblent danser dans la lumière et animer l'espace d'une convivialité propagatrice. (7)
La marque de fabrique de Claude Viallat, (né en 1936) est, elle aussi, bien connue des amateurs d'art contemporain. A priori son motif, une forme neutre, rectangulaire, ondulée, ne stimule pas l'imaginaire mais permet moult déclinaisons. C'était une gageure d'en faire un motif religieux (1993). Et pourtant, à N.D. des Sablons d'Aigues-Mortes, dans le Gard, un édifice du XIIIème siècle, "ces haricots" colorés, régulièrement espacés dessinent dans leur alignement une croix. Et leurs couleurs vives, se projetant par instants sur la pierre, semblent danser dans la lumière et animer l'espace d'une convivialité propagatrice. (7)
Avec Matisse comme référence, François Rouan (né en 1943),  a créé un découpé-tressé très personnel. En 1995, lui est confiée la conception de 9 vitraux gravés pour l'église St Jean Baptiste de Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Il a joué sur deux séries de couleurs, peintes à la grisaille, les bleues pour les parties romanes, les jaunes pour les parties XIXème et XXème siècles. Chacun verra dans ce motif de tressage de simples dessins géométriques tout à fait profanes ou quelque pléiade divine. (8)
a créé un découpé-tressé très personnel. En 1995, lui est confiée la conception de 9 vitraux gravés pour l'église St Jean Baptiste de Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Il a joué sur deux séries de couleurs, peintes à la grisaille, les bleues pour les parties romanes, les jaunes pour les parties XIXème et XXème siècles. Chacun verra dans ce motif de tressage de simples dessins géométriques tout à fait profanes ou quelque pléiade divine. (8)
René Guiffrey , né en 1938, s'est installé au pied du Mont Ventoux qu'il aime voir de son village.  En 2020, il a réalisé une commande pour les 2 petites églises de Bédoin et du Beaucet. Sa technique, très personnelle née de recherches sur le verre lui a permis de réaliser six vitraux dans lesquels la transparence de ce médium accrocheur cliquette, varie dans la lumière et apporte délicatesse et gaité à ces architectures romanes dépouillées et plutôt ramassées sur elles mêmes. (9)
En 2020, il a réalisé une commande pour les 2 petites églises de Bédoin et du Beaucet. Sa technique, très personnelle née de recherches sur le verre lui a permis de réaliser six vitraux dans lesquels la transparence de ce médium accrocheur cliquette, varie dans la lumière et apporte délicatesse et gaité à ces architectures romanes dépouillées et plutôt ramassées sur elles mêmes. (9)
Elles sont nombreuses aujourd'hui les églises à être revues par la modernité, je n'en citerai que deux autres parce qu'elles l'ont été par des artistes femmes.
 Aurelie Nemours (1910-2005) a fait partie des peintres "abstraits-géométriques" et, comme telle on ne trouve de sa main que des œuvres d'une grande austérité. A N.D. de Salagon (Haute Provence) , en1997, elle a développé un ensemble de vitraux monochromes pourpres qui inondent d'une intense lumière rouge l'intérieur de l'édifice. Pas de référence au réel mais plutôt, dans un exercice d'ascèse, une apologie de cette couleur, intense, chaude, profonde, exceptionnelle dans un lieu religieux. Comme chez Soulages, la couleur est uniforme mais le quadrillage structurel plus présent et plus rectiligne donne à l'ensemble un caractère solennel propre à la spiritualité. (10)
Aurelie Nemours (1910-2005) a fait partie des peintres "abstraits-géométriques" et, comme telle on ne trouve de sa main que des œuvres d'une grande austérité. A N.D. de Salagon (Haute Provence) , en1997, elle a développé un ensemble de vitraux monochromes pourpres qui inondent d'une intense lumière rouge l'intérieur de l'édifice. Pas de référence au réel mais plutôt, dans un exercice d'ascèse, une apologie de cette couleur, intense, chaude, profonde, exceptionnelle dans un lieu religieux. Comme chez Soulages, la couleur est uniforme mais le quadrillage structurel plus présent et plus rectiligne donne à l'ensemble un caractère solennel propre à la spiritualité. (10)
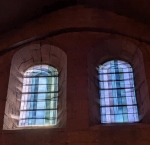
 Geneviève Asse (1923- 2021) disait qu'elle cherchait la couleur qui capte mieux la lumière. et c'est dans sa Bretagne natale que cette très grande artiste la trouvée, un bleu limpide et toujours nuancé, à la fois la mer, le ciel et le silence dans un dépouillement absolu. A la Collégiale de Lamballe où se déploie un mélange de vitraux de différentes époques, elle a créé avec le peintre abstrait Olivier Debré (1920-1999) un ensemble de 21 verrières et 3 oculi, d'une grande sobriété , à lui les jaunes émotionnels, à elle les bleus sereins. Ils cohabitent harmonieusement à l'image de la vie, à la fois cruelle et bienveillante. Les autres vitraux qu'elle a réalisé à Saint Dié des Vosges sont peut-être encore plus significatifs du pouvoir de ce bleu à la fois intense et léger que les croyants reconnaitront comme un appel deDieu. (11) .
Geneviève Asse (1923- 2021) disait qu'elle cherchait la couleur qui capte mieux la lumière. et c'est dans sa Bretagne natale que cette très grande artiste la trouvée, un bleu limpide et toujours nuancé, à la fois la mer, le ciel et le silence dans un dépouillement absolu. A la Collégiale de Lamballe où se déploie un mélange de vitraux de différentes époques, elle a créé avec le peintre abstrait Olivier Debré (1920-1999) un ensemble de 21 verrières et 3 oculi, d'une grande sobriété , à lui les jaunes émotionnels, à elle les bleus sereins. Ils cohabitent harmonieusement à l'image de la vie, à la fois cruelle et bienveillante. Les autres vitraux qu'elle a réalisé à Saint Dié des Vosges sont peut-être encore plus significatifs du pouvoir de ce bleu à la fois intense et léger que les croyants reconnaitront comme un appel deDieu. (11) .
C'est une nouvelle technique, dite du" verre décoré" qu'a utilisé le peintre Zao Wou Ki pour les vitraux du réfectoire du prieuré St Cosme à La Riche, demeure de Ronsard, près de Tours. Sans les résilles de plomb habituelles, la transparence est totale et le motif apparait comme une aquarelle... magique.
vitraux du réfectoire du prieuré St Cosme à La Riche, demeure de Ronsard, près de Tours. Sans les résilles de plomb habituelles, la transparence est totale et le motif apparait comme une aquarelle... magique.
Le musée Soulages à Rodez expose Geneviève Asse " Le bleu prend tout ce qui passe", jusqu'au 18 mai 2025