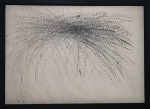Au gré de mes pérégrinations dans les galeries parisiennes et de mes visites de musées, j'avais vu des œuvres de Bernard Réquichot. Je les trouvais intenses et même inquiétantes sans éprouver le besoin d'en savoir plus. Mais voir une rétrospective de son travail est une toute autre expérience. Appréhendé dans son ensemble son cheminement acquiert une grande cohérence et une incontestable puissance. Une force nous empoigne et nous bouleverse. Il serait donc dommage de rater l'exposition qui se tient actuellement au Centre Pompidou et qui est remarquablement bien faite.
Né en 1929, Bernard Réquichot quitte sa Sarthe natale à 17 ans pour monter à Paris où il se forme à l'école des Beaux-Arts. Il se suicide en 1961, la veille d'une exposition que lui consacrait Daniel Cordier. Il avait alors 32 ans. Son œuvre inquiète s'étale donc seulement sur une dizaine d'années. Au cours de sa courte vie, il fut d'abord peintre puis diversifia sa pratique en l'élargissant au dessin, au collage. Il fabriquât aussi de bien étranges reliquaires.
 Les premières peintures exposés sont figuratives, de style plutôt cubiste, tels Sans titre ou Le bœuf assis (à la Juan Gris) (photo 1) toutes deux de 1953. Dans les œuvres de cette période l'artiste avait l'habitude de mélanger à son médium de la sciure de plastique récupérée dans une usine et du sable. Cet ajout procure à son travail une sensation tactile proche de celle éprouvée devant une tapisserie. Mais il abandonne rapidement ce style figuratif au profit d'une abstraction gestuelle et matiériste qui lui permet d'exprimer le mal être qui l'habite.
Les premières peintures exposés sont figuratives, de style plutôt cubiste, tels Sans titre ou Le bœuf assis (à la Juan Gris) (photo 1) toutes deux de 1953. Dans les œuvres de cette période l'artiste avait l'habitude de mélanger à son médium de la sciure de plastique récupérée dans une usine et du sable. Cet ajout procure à son travail une sensation tactile proche de celle éprouvée devant une tapisserie. Mais il abandonne rapidement ce style figuratif au profit d'une abstraction gestuelle et matiériste qui lui permet d'exprimer le mal être qui l'habite.  Travaillées au couteau ses œuvres sont alors des jaillissements de tiges de végétaux striés de traces saccadées rouges et noires (photo 4). Ce sont d'inextricables enchevêtrements de cordes, de fils telle cette huile sur toile Sans titre (1956) (photo 2) qui n'est pas sans évoquer un crane en ébullition.
Travaillées au couteau ses œuvres sont alors des jaillissements de tiges de végétaux striés de traces saccadées rouges et noires (photo 4). Ce sont d'inextricables enchevêtrements de cordes, de fils telle cette huile sur toile Sans titre (1956) (photo 2) qui n'est pas sans évoquer un crane en ébullition.
 Parallèlement Requichot peint des formes biologiques, telluriques ou cosmiques qui se détachent sur des fonds uniformes. Ainsi avec Sans titre de 1956 on assiste à la formation d'un objet qui jaillit d'un magma en ébullition (photo 3).
Parallèlement Requichot peint des formes biologiques, telluriques ou cosmiques qui se détachent sur des fonds uniformes. Ainsi avec Sans titre de 1956 on assiste à la formation d'un objet qui jaillit d'un magma en ébullition (photo 3). En 1957 ses tableaux atteignent un paroxisme visuel. A titre d'exemple regardons L'Episode de la guerre des nerfs (1957) (photo 4) où, de formes enchevêtrées de façon très serrée, s'échappent des tiges spiralées, sorte de ressorts, que l'artiste dessine de façon obsessionnelle et où des morceaux déchiquetés de peintures antérieures parsèment la surface. Avec Sans titre (photo 5), exécutée la même année, il nous fait assister à une déflagration de matières diverses. A des entrecroisements de coups de brosse à l'acrylique se mêlent des illustrations de magazine et des objets puisés dans la nature tels ces plus de paon ou de faisan.
En 1957 ses tableaux atteignent un paroxisme visuel. A titre d'exemple regardons L'Episode de la guerre des nerfs (1957) (photo 4) où, de formes enchevêtrées de façon très serrée, s'échappent des tiges spiralées, sorte de ressorts, que l'artiste dessine de façon obsessionnelle et où des morceaux déchiquetés de peintures antérieures parsèment la surface. Avec Sans titre (photo 5), exécutée la même année, il nous fait assister à une déflagration de matières diverses. A des entrecroisements de coups de brosse à l'acrylique se mêlent des illustrations de magazine et des objets puisés dans la nature tels ces plus de paon ou de faisan.
La belle série des Traces graphiques de 1958 qui entretient, comme son nom l'indique, une relation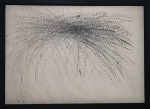 ambigüe avec l'univers du dessins, est d'un tout autre registre. Arachnéa (photo 6) peint en janvier 1958, en est un bel exemple. Une gerbe de lignes constituées de petits ponts noirs, si fins qu'on pense à une toile d'araignée, explose et envahit avec légèreté le fond blanc de la toile.
ambigüe avec l'univers du dessins, est d'un tout autre registre. Arachnéa (photo 6) peint en janvier 1958, en est un bel exemple. Une gerbe de lignes constituées de petits ponts noirs, si fins qu'on pense à une toile d'araignée, explose et envahit avec légèreté le fond blanc de la toile.
 Parallèlement à son travail picturale Bernard Requichot exécute aussi plusieurs séries de dessins à l'encre où prolifèrent des spirales. Souvent rehaussées de gouache blanche, ils se déploient sur de grandes feuilles de papier blanc et sont à la fois inquiétants, gracieux et tourmentés. Ces dessins très fins évoquent des organismes troublants assez proches de ceux exécutés par son ami Fred Deux (Photo 7). Ces spirales seront prolongées en 3 dimensions avec la sculpture Nekong tanten tank mana (1959-1960) composée de circonvolutions d'anneaux de polystyrène collés les uns aux autres, enfermes dans une vitrine. Créature zoomorphe qui, de son œil de prédateur, guette sa proie.
Parallèlement à son travail picturale Bernard Requichot exécute aussi plusieurs séries de dessins à l'encre où prolifèrent des spirales. Souvent rehaussées de gouache blanche, ils se déploient sur de grandes feuilles de papier blanc et sont à la fois inquiétants, gracieux et tourmentés. Ces dessins très fins évoquent des organismes troublants assez proches de ceux exécutés par son ami Fred Deux (Photo 7). Ces spirales seront prolongées en 3 dimensions avec la sculpture Nekong tanten tank mana (1959-1960) composée de circonvolutions d'anneaux de polystyrène collés les uns aux autres, enfermes dans une vitrine. Créature zoomorphe qui, de son œil de prédateur, guette sa proie.
A la fin de sa courte vie, Requichot renouvelle en profondeur son art exécutant de grands collages qu'il baptise Papiers choisis. Pour ce faire il prélève dans des revues à grand tirage, dont il se procure plusieurs exemples, des images banales qu'il découpe compulsivement (torchons de cuisine, animaux, gâteaux industriels....) et qu'il rassemble de façon à créer d'inquiétantes formes figuratives.  Quelques exemples de cette façon de procéder sont donnés dans l'exposition, dont La cocarde, le déchet des continents de 1961 (photo 8). Ce collage est constitué de deux motifs antithétiques : une pâtisserie industrielle et un museau de chien collé à l'envers. Répété et associés à d'autres images, ces motifs, rehaussés de peintures, dessinent une sorte de végétation fantastique et inquiétante (photo).
Quelques exemples de cette façon de procéder sont donnés dans l'exposition, dont La cocarde, le déchet des continents de 1961 (photo 8). Ce collage est constitué de deux motifs antithétiques : une pâtisserie industrielle et un museau de chien collé à l'envers. Répété et associés à d'autres images, ces motifs, rehaussés de peintures, dessinent une sorte de végétation fantastique et inquiétante (photo).
La fabrication de reliquaires a toujours accompagné son travail. A l'inverse de ceux qu'on trouve dans les églises et qui renferment des fragments de corps sanctifiés, ceux de Réquichot ne contiennent que des débris de la nature ou des rebuts manufacturés qu'l recouvre entièrement et rageusement d'une épaisse couche de peinture et qu'il enferme dans des boîtes en bois recouvertes de tissus. Nappage protecteur ou suc gastrique destructeur qui enduit ou détruit ce qu'il recouvre en le dissimulant.  Ainsi Le reliquaire de la forêt (1957-58) (photo 8) contient des ossements d'animaux, morceaux de bois, racines, ficelles.... La maison du manège endormi (1957-58) des ossements d'animaux, chaussures, bois, champignons fragments de toile peintes à l'huile. Le plus monumental est L'armoire de Barbe bleue dont le titre renvoie à celui d'un conte cruel et inquiétant. Il contient des rouleaux de toile enduites de peinture épaisse, serré les uns contre les autres. Figureraient-ils des corps de femmes assassinées ?
Ainsi Le reliquaire de la forêt (1957-58) (photo 8) contient des ossements d'animaux, morceaux de bois, racines, ficelles.... La maison du manège endormi (1957-58) des ossements d'animaux, chaussures, bois, champignons fragments de toile peintes à l'huile. Le plus monumental est L'armoire de Barbe bleue dont le titre renvoie à celui d'un conte cruel et inquiétant. Il contient des rouleaux de toile enduites de peinture épaisse, serré les uns contre les autres. Figureraient-ils des corps de femmes assassinées ?
On a souvent rapproché l'œuvre de Bernard Réquichot de celle d'Antonin Artaud. Tous deux en effet expriment leur extrême difficulté d'exister. Mais si le second en traduit la douleur, le premier dévoile avec rage et insistance le dérèglement de son esprit.
Bernard REQUICHOT. Je n'ai jamais commencé à peindre. Centre Pompidou, Galerie Ouest, 4ème étage. 4 Place Georges Pompidou, 75004-Paris. Jusqu'au 2 septembre. (fermé mardi)